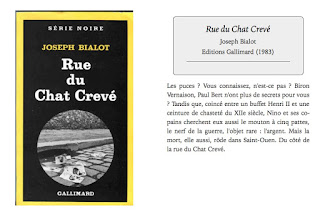DOA Le serpent aux mille coupures (Série Noire) 2009
C’est le troisième roman de cet auteur que je lis en deux mois. Une valeur sûre. Vidéo de l'auteur parlant très bien de son livre.
Une nuit, un paysan de Moissac, Baptiste Latapie est en train de saboter avec une tenaille les palissages d’un vigneron concurrent. Son tort ? C’est un noir qui s’est marié avec la fille d’un propriétaire et que les paysans du coin aimeraient faire déguerpir . Le saboteur est interrompu par l’arrivée d’une voiture.
Changement de point de vue: dans le véhicule, des mafieux colombiens venus traiter des affaires avec des collègues italiens....
Par un hasard incroyable, le sbire et chauffeur des mafieux tombe sur un accidenté de la route, moto renversée dans un fossé. On ne veut pas de témoin: pas de quartier pour le blessé. Sauf que le blessé n’est pas monsieur tout le monde...
Pendant ce temps-là, sur les routes de la région, les gendarmes patrouillent à la recherche d’un fugitif. On le comprend à la fin du roman, on est juste après Citoyens clandestins. Le lecteur trouvait bien une certaine ressemblance à un personnage...
Ensuite, nous aurons droit à une prise d’otage dans une ferme isolée et à la confrontation entre le preneur d’otage, un homme blessé, un professionnel dur et en fuite, et la petite famille, la femme, le fermier, la petite fille et le chien...
Un tueur sans pitié commandité par la mafia (le fameux serpent) arrive pour nettoyer le merdier, il va mettre les polices françaises et espagnoles sur les dents et faire des dégâts dans la paysannerie locale ...
Encore un bon roman de DOA après Citoyen clandestin. J’ai retrouvé la sobre efficacité des Manchette comme par exemple La position du tireur couché avec en plus son talent pour nous faire vivre plusieurs points de vue avant de joindre les fils narratifs à la fin.
150 pages qui se lisent en un éclair.